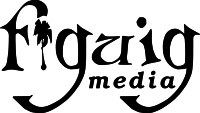Nichée aux confins orientaux du Maroc, la ville de Figuig 🇲🇦 est bien plus qu’un joyau oasien. C’est un creuset culturel où l’histoire, la tradition et la langue tissent un patrimoine immatériel unique. La langue régionale de Figuig, issue d’un long métissage culturel, en est le témoin vivant. Cette langue, souvent méconnue hors de ses frontières naturelles, constitue pourtant une richesse linguistique à part entière, qui mérite d’être explorée, préservée et valorisée.
Les origines de la langue régionale de Figuig
La langue parlée à Figuig appartient au groupe des langues berbères, plus précisément au tamazight zénète. Cette branche est différente du tamazight central et du chleuh, parlés dans d’autres régions du Maroc. À Figuig, le parler local est souvent désigné sous le terme de « figuigui » ou « amazighe zénète », et il se distingue par sa phonétique, son lexique et sa structure grammaticale 🗣️.
Cette variante zénète est un héritage des anciennes confédérations berbères qui occupaient la région bien avant l’arrivée de l’arabe au Maghreb. Malgré l’arabisation progressive du pays, la langue régionale de Figuig a su conserver sa singularité. Elle est encore aujourd’hui parlée dans les ksour (villages fortifiés) de la ville, notamment Zenaga, Loudaghir ou encore Oulad Slimane.
Une grammaire propre, riche et vivante
La langue régionale de Figuig présente des structures grammaticales fascinantes, proches du tamazight général mais avec des spécificités locales. Elle repose sur des racines trilitères (trois consonnes principales) autour desquelles s’articulent les mots grâce à des schémas vocaliques 🧩.
Par exemple, les verbes subissent des mutations selon le temps, l’aspect et la personne. On observe aussi un emploi intensif des préfixes et suffixes pour marquer le genre, le nombre et la relation syntaxique. Contrairement à l’arabe classique, la structure SVO (Sujet-Verbe-Objet) est commune, bien que la flexibilité grammaticale permette des variations stylistiques intéressantes.
Les noms et adjectifs sont également accordés selon des règles strictes mais logiques, et l’emploi du duel (forme grammaticale entre le singulier et le pluriel) se retrouve parfois dans les expressions anciennes, bien que son usage soit en recul.
Expressions typiques : entre poésie et quotidien
L’un des charmes les plus séduisants de la langue régionale de Figuig réside dans ses expressions idiomatiques. Elles traduisent l’âme du peuple figuigui : poétique, directe, et imprégnée du désert 🌵.
Voici quelques exemples glanés lors de discussions avec des locuteurs natifs :
- « Immi n ttawant » – littéralement « la mère des villes », une manière de parler affectueusement de Figuig.
- « Yella i ugharas » – « Il est sur le chemin », une façon subtile de dire qu’une personne suit sa destinée.
- « Amek yeshkh iwen? » – « Comment va ta santé ? », question usuelle exprimant un réel souci de l’autre.
Ces expressions, parfois intraduisibles littéralement, véhiculent des valeurs de respect, d’hospitalité et de spiritualité. Elles sont enseignées de génération en génération, souvent dans un cadre oral, en famille ou lors de fêtes locales 🎉.
La transmission par la voix et la vidéo : un enjeu moderne
Aujourd’hui, dans un contexte de mondialisation et d’uniformisation culturelle, la langue régionale de Figuig est confrontée à un double défi : celui de sa conservation et de sa transmission. Si l’arabe dialectal et le français dominent les sphères publique et éducative, les jeunes générations figuiguis montrent un regain d’intérêt pour leur langue ancestrale grâce aux outils numériques 🎥💻.
Des initiatives locales et individuelles émergent sur les réseaux sociaux. De jeunes vidéastes, enseignants et passionnés de culture amazighe produisent des vidéos pédagogiques sur YouTube ou TikTok, expliquant la grammaire figuigui, proposant des cours de conversation ou mettant en scène des sketchs humoristiques en langue locale.
Ces contenus viraux jouent un rôle crucial : ils revitalisent une langue parfois perçue comme « ancienne » et la reconnectent avec la réalité contemporaine. Ils encouragent aussi les diasporas figuiguis, notamment en France, en Belgique et au Canada, à renouer avec leurs racines linguistiques 🌍.
L’importance d’une reconnaissance institutionnelle
Malgré cet engouement populaire, la langue régionale de Figuig reste peu reconnue dans les politiques linguistiques nationales. Bien que le tamazight soit désormais langue officielle du Maroc aux côtés de l’arabe, la pluralité des variantes régionales reste peu intégrée aux programmes scolaires.
À Figuig, l’introduction de la langue amazighe dans l’enseignement reste timide. Des associations culturelles militent pour que le parler figuigui soit documenté, normé et enseigné, non seulement dans les écoles, mais aussi à travers des festivals culturels, des publications et des plateformes numériques.
L’Institut Royal de la Culture Amazighe (IRCAM) a amorcé un travail de recensement linguistique, mais des efforts supplémentaires sont nécessaires pour que cette langue locale ne soit pas réduite à un simple souvenir ethnographique.
Une langue vivante, ancrée dans la mémoire collective
La langue régionale de Figuig est bien plus qu’un outil de communication : elle est le miroir d’un mode de vie, d’une vision du monde, d’un rapport à l’autre et à la nature. Elle est présente dans les chants traditionnels, dans les proverbes transmis au coin du feu 🔥, dans les récits des anciens, mais aussi dans les conversations quotidiennes autour du thé à la menthe 🍵.
Sa beauté réside dans sa capacité à exprimer avec subtilité des sentiments, à nommer des réalités propres à l’univers saharien, et à porter une histoire millénaire dans chacun de ses mots.
Préserver cette langue, c’est préserver une part essentielle de l’identité marocaine. C’est reconnaître que la diversité linguistique est une richesse à célébrer, et non un vestige du passé à oublier.